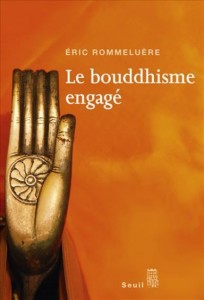L’amour et la compassion, les deux règles des bodhisattvas
Le Bouddha Śākyamuni enseigne l’universalité de duḥkha, un terme sanskrit souvent traduit par « souffrance », mais qui embrasse plus sûrement des sentiments comme l’insatisfaction, l’insécurité, la frustration ou la peur. Son analyse est psychologique et phénoménologique : la vie est un processus sans cesse renouvelé où, à tout moment, l’existence peut s’effondrer malgré son apparente solidité. Notre identité se construit en masquant la fragilité et l’irréductible nudité de l’être ; cette occultation produit une angoisse existentielle, le plus souvent inaperçue, qui nous étreint au plus profond de nous-mêmes. La volonté de maîtrise, nombre de comportements, les habitudes du quotidien, sont autant de stratégies inconscientes pour tenter de sécuriser ce qui ne peut l’être. L’éveil, tel que l’entend le Bouddha, n’est rien d’autre que le dévoilement de la nudité et de la fragilité, son acceptation joyeuse, et par là même le dénouement de l’angoisse en cette vie ; le dharma, son enseignement, désigne un ensemble de dispositifs thérapeutiques destinés à rompre les processus qui alimentent l’angoisse existentielle.
Chaque sentiment se doit d’être « illimité » pour embrasser la foule des êtres. Mais aimer ses ennemis comme soi-même ne va pas forcément de soi. Le disciple du Bouddha doit donc s’exercer sans relâche afin d’élargir le cercle d’inclusion, depuis l’amour qu’il se porte à lui-même jusqu’à aimer l’être le plus étranger, le plus vil, sans que jamais un quelconque sentiment d’animosité ou de colère ne surgisse. Il médite sur les avantages et les désavantages de l’amour, il voit en son ennemi le père ou la mère qu’il a sûrement été dans une vie passée. L’équanimité clôt la liste ; elle embrasse les trois autres sentiments qui peuvent être encore subtilement inclinés : on aime l’un plutôt que l’autre. Car il s’agit d’avoir la même disposition envers son ami qu’envers son ennemi. Dans cette perspective, l’amour d’autrui ne s’oppose pas à l’amour de soi, l’un ne se substitue pas à l’autre et l’équanimité les unifie tout autant. Les quatre illimités présentent un double aspect, à la fois comme disposition et comme action (comme tout sentiment d’ailleurs : j’ai peur, tout mon être tremble et je m’enfuis – ou j’attaque, tout dépend justement de ma disposition). Dans les formulations du bouddhisme ancien, l’accent porte plus sur la disposition que sur l’action ; les quatre illimités sont d’ailleurs souvent qualifiés de « pensées illimitées ». L’attitude mentale prévaut sur l’acte puisqu’elle le colore et l’anime.
Hors de cette présentation quadripartite, le terme de karuṇā, la compassion, est généralement associé aux exercices méditatifs dans les textes anciens. L’engagement aimant dans l’épaisseur du monde sera plus volontiers désigné par des termes comme maitrī, l’amour (pāli mettā) ou encore par anukampā, le souci. Souvent cité, le Livre de l’amour (Mettā sutta) de l’école theravāda est exemplaire :
« Ainsi qu’une mère au péril de sa vie surveille et protège son enfant unique, ainsi avec un esprit sans entraves doit-on chérir toute chose vivante, aimer le monde en son entier, au-dessus, au-dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie. »
La Voie de la Grandeur ou plus littéralement le Grand Véhicule (skt. mahāyāna) est un mouvement de réforme qui apparaît en Inde en marge des anciennes écoles bouddhistes au tout début de l’ère chrétienne pour s’épanouir ensuite dans un foisonnement d’écoles par-delà l’Himalaya et dans tout l’Extrême-Orient, du Tibet au Japon. Cinq siècles après la mort du Bouddha, ses adeptes entendaient restaurer ses enseignements à leurs yeux corrompus. Ils reprirent et explorèrent les grandes idées-forces de ses instructions, souvent avec de nouveaux éclairages. Amplifiant et dépassant le cadre des quatre illimités des anciennes écoles, la Voie de la Grandeur fait ainsi du souci du monde le principe directeur du dharma, il est la clé qui ouvre en grand la porte de l’éveil. Explicitement associé à karaṇa, l’agir, le terme de karuṇā, la compassion, prend une tout autre ampleur. Ce rapprochement sémantique permet, selon un procédé exégétique courant de l’Inde ancienne, d’en renouveler la signification : le souci doit provoquer un agir aimant en ce monde.
Dès les origines, la communauté des disciples du Bouddha était quadripartite, composée de moines, de moniales, de fidèles de sexe masculin et de fidèles de sexe féminin. Les moines auxquels tout travail était défendu, toute possession interdite hormis quelques ustensiles, offraient leurs enseignements ; les laïcs, en retour, entretenaient la communauté monastique selon une logique de dons réciproques. Les adeptes de la voie de la Grandeur, les « êtres d’éveil » ou bodhisattvas, ne forment cependant pas une nouvelle et cinquième catégorie qui se rajouterait aux quatre autres. Seule l’aspiration à l’éveil et à l’amour-compassion fait le bodhisattva, indépendamment de son statut religieux. Le moine et le laïc ne sont plus simplement engagés dans une relation de réciprocité, ils sont désormais alliés dans le projet affirmé d’un don sans retour, leur regard aimant résolument tourné vers la foule des êtres. Un passage de cette littérature est exemplaire :
Le bodhisattva Avalokiteśvara s’adressa au Bouddha et lui dit : « Ô Vénéré du monde, un bodhisattva ne devrait pas étudier beaucoup d’enseignements. Ô Vénéré du monde, si un bodhisattva reçoit et préserve un seul enseignement, s’il connaît bien un seul enseignement, l’ensemble de tous les autres enseignements du Bouddha se tiennent naturellement dans sa main. Ô Vénéré du monde, quel est ce seul enseignement ? C’est la grande compassion. Si un bodhisattva pratique la grande compassion, l’ensemble de tous les enseignements du Bouddha tiennent au creux de sa main. »
Dans l’existence ordinaire, l’amour et la compassion ont déjà de positives valeurs. Mais ces sentiments doivent être épurés de leurs formes élémentaires comme la pitié et la commisération. L’amour-compassion n’attend ni ne juge, comme l’est subtilement une forme de pitié qui ne voit que le pitoyable et le misérable, pas plus qu’elle ne se confond avec la tristesse. La grande compassion, enfin, à laquelle les bodhisattvas aspirent n’est pas comprise comme un affect réactif, elle est un pur jaillissement. Pour les bouddhas et les êtres les plus accomplis, la grande compassion ne peut relever ni de l’émotion ni de la raison. Pourtant, n’est pas bouddha qui veut et la compassion se vivra plus ordinairement dans le processus d’ouverture à la vie éveillée, à la fois comme émotion et comme raison. Ainsi l’adepte pourra toujours trouver des raisons à l’amour-compassion : car tous les êtres ont été ses pères et ses mères au cours d’innombrables vies – l’explication est commune. Dans son cheminement, le disciple du Bouddha se doit également de discerner l’angoisse existentielle des êtres par-delà leur souffrance physique, morale ou psychologique. Sa compassion se tient aussi là, pour « sauver l’homme », et qu’il se convertisse à une autre dimension de lui-même.
L’exigence intérieure conduit ainsi le disciple à déployer une morale vive qui oriente tous ses actes. Vécus pleinement comme dispositions morales, l’amour et la compassion font de tout geste (qui ne se réduit pas dans les enseignements bouddhistes à l’acte physique ; l’acte est triple, à la fois corporel, vocal et mental) un agir moral. Cet amour et cette compassion-là ne demandent rien à autrui. Tout se joue dans la sollicitude qui se décline non sous un mode égalitaire, mais inégalitaire, décrit comme la relation d’une mère avec son enfant (la métaphore peut d’ailleurs s’inverser, inégalité ne signifie pas hiérarchie : l’adepte pourra tout autant considérer les êtres comme ses propres parents).
Les enseignements se nourrissent d’éloges à l’amour et à la compassion, d’une littérature édifiante où le Bouddha lui-même, au cours de ses vies passées, s’offre en pâture à des fauves blessés. Sans être un éveillé, ces dispositions réorientent déjà et totalement la perception du monde, de soi et d’autrui. Le nomade des hauts plateaux tibétains le sait bien, l’amour et la compassion donnent sens à son existence sans qu’il ait besoin de devenir un renonçant. Elles structurent une morale du quotidien qui ne fonde pas son agir en référence à des principes abstraits, mais sur ses propres capacités à vivre une existence authentique. L’exercice ramène sans cesse dans l’épaisseur du monde – hier comme aujourd’hui.