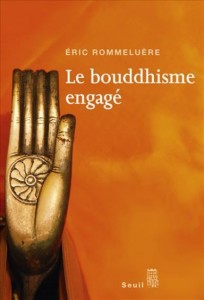Vivre ensemble suppose des règles de tolérance et de respect, des règles de justice aussi. Serait-ce suffisant ? Pour un disciple du Bouddha, le vivre ensemble est le plus intense des champs d’éveil. Celui-ci explore de puissantes questions : comment intégrer l’autre dans son apprentissage de l’éveil ? Comment préserver son intégrité physique et mentale lorsqu’il se trouve oppressé, opprimé ou réprimé ? Comment simplement le réintégrer dans la vie ? À titre d’aide-mémoire, les bodhisattvas disposent d’une liste de conduites nommée « les quatre méthodes intégratives » : le don, les paroles aimantes, les actions profitables et la coopération. Leurs actions ne peuvent évidemment se réduire à quatre conduites ; elles condensent et résument simplement leur compréhension du vivre-ensemble. Pour tout pratiquant de la Grandeur, le défi consiste aujourd’hui à déployer ces méthodes hors des relations immédiates de proximité, afin qu’elles soient aussi comprises comme des outils de métamorphose sociale et politique. À rebours des valeurs d’individualisme et de compétition, elles pourraient alors constituer les prémisses d’un manuel bouddhiste de la critique sociale.
Le don
Des dons les plus infimes aux sacrifices les plus grands, le don, dans son immense variété, nourrit l’existence. Certains dons sont motivés par la crainte, d’autres par les contraintes ou les jeux de pouvoir. On peut donner par obligation (le cadeau que l’on se sent obligé de rendre), par intérêt (le don pour recevoir en échange) ou encore par solidarité intergénérationnelle (le don entre parents et enfants). Pour les disciples du Bouddha, le don n’est pas un dû, il est la seule bonté du cœur.
Les enseignements distinguent formellement trois sortes de don, à savoir le don matériel, le don du respect et le don du dharma. Lorsqu’il offre un bien matériel, le disciple du Bouddha ne répond pas aux désirs ou aux flatteries, mais aux besoins. Le Bouddha a énuméré quatre besoins communs à tous les êtres humains : se nourrir, se vêtir, avoir un toit et se soigner. Celui qui nourrit l’affamé et désaltère l’assoiffé, celui qui habille l’indigent démuni, celui qui abrite l’égaré qui ne possède plus de toit, celui qui soigne le malade alité, tous restaurent l’intégrité menacée. Le Bouddha expliquait : « Lorsqu’un donateur offre de la nourriture, il procure cinq choses, la vie, le teint, la force, le plaisir et l’intelligence. » Bien entendu, l’énumération, composée dans une société traditionnelle, ne peut être interprétée comme une liste restrictive de quatre besoins fondamentaux, et les bodhisattvas des temps modernes ont, à leur tour, le devoir de reconnaître la diversité des besoins actuels. L’alphabétisation et l’éducation sont désormais tout autant essentiels.
Le second don, le don du respect, souligne le besoin de tout être humain d’être entendu, reconnu et soutenu. Le respecter signifie également savoir entendre ce qu’il n’ose ou ce qu’il ne peut dire, ce qu’il doit taire aussi, et respecter ses pudeurs ; avoir l’intelligence pour le devancer, pour l’accompagner, pour le suivre et parfois le laisser seul. Le troisième don, le don du dharma, affirme enfin le besoin de chacun de trouver une signification et une cohérence dans sa propre vie.
Même si on offre plus naturellement à ceux qui sont dans le besoin immédiat, il n’existe aucune limitation au don. Le don matériel, le don du respect, le don du dharma peuvent être offerts autant à soi-même qu’à la multitude. Chacun a de multiples retenues au don. Nous pouvons dire « je ne peux pas » ou bien encore « il ne le mérite pas ». Nous pouvons également être bienveillants avec nos amis, mais récalcitrants avec d’autres. La bonté du cœur requiert une constance dans l’élargissement.
Notre société moderne, qui fait de la plupart des ressources et des objets des marchandises inscrites dans un circuit économique, oblitère le don. L’achat, la vente, la production, la consommation sont entièrement rabattus sur leur objet sans plus guère de considération pour la relation humaine qui se trouve, elle aussi, rationalisée. À présent, acheteurs et vendeurs n’ont même plus la nécessité de se rencontrer, il suffit d’un simple clic sur Internet. Et pourtant le don résiste, s’infiltre dans de nouveaux espaces. Ressort nécessaire de notre humanité, il inspire l’imaginaire collectif. L’abbé Pierre est longtemps resté la « personnalité préférée des Français » ; Coluche n’est pas simplement l’humoriste provocateur, il demeure dans la mémoire collective comme le fondateur des Restos du Cœur. Une autre culture de la relation et de l’association, fondée sur la générosité (le don) et le bénévolat (la gratuité), double la culture du profit et de la spéculation. Le dynamisme du tissu associatif en témoigne amplement. Simplement, cantonné à la périphérie des représentations sociales et politiques, le don n’est plus affirmé comme une valeur déterminante et structurante des relations humaines – ce qu’il est pourtant.
Les paroles aimantes
À l’ère de la communication, celle-ci s’accompagne d’une multitude de bruits. Tout peut s’entendre désormais sans que l’on puisse toujours distinguer le vrai du faux, l’information de la désinformation. De nouveaux discours légitimés, institués mais dans le fond manipulateurs prospèrent aussi, la publicité et toutes sortes de langages démagogiques. À l’évidence, nous vivons également dans une époque où l’insignifiance des mots a pris une place croissante. Mais s’il est possible de parler pour ne rien dire, il l’est également pour dire, autrement dit pour construire l’humain : le commerce de la pensée, le dialogue ont une fonction instituante. L’interlocution reconnaît le même en l’autre. Elle permet de partager avec lui une même communauté, une même humanité, une même responsabilité. Dans la parole saine, l’autre n’est pas pris en otage, il est le sujet laissé à lui-même. Et c’est seulement avec l’autre, lorsqu’il est considéré comme tel, que peut s’instaurer un dialogue. Dans le plus simple échange verbal, on ne profère pas juste quelques mots, on « donne sa parole », on s’engage pour autrui, et on l’engage à son tour. Reconnaissant toutes ces multiples dimensions, le disciple du Bouddha délaisse l’invective et la violence des mots, car il sait le poids de la parole qui peut tantôt blesser et tantôt guérir, tantôt humilier et tantôt relever. Il puise dans sa pratique de l’amour et sa parole se fait aimante. D’emblée, une parole aimante repose, réconcilie, et fait déposer les armes.
Les actions profitables
Pour un disciple du Bouddha, toute action entreprise doit profiter sans retenue, à soi comme à autrui, au proche comme au lointain, et s’étendre même jusqu’aux arbres et aux rivières. Dans un nouveau modèle économique à imaginer, la Terre, les êtres vivants et l’ensemble des ressources naturelles ne seraient plus réduites à du matériel, et notre habitat (oikos) serait autrement géré (nomos). D’un point de vue écologique, l’espèce humaine est une association organisée qui transforme les ressources vivantes et non vivantes au sein de la biosphère. Comme tout écosystème en équilibre instable, il ne peut trouver sa pérennité que dans un jeu complexe d’actions et de rétroactions. Une nouvelle économie ne peut se contenter de réguler ou de diminuer l’exploitation de ressources naturelles : elle doit repenser intégralement la contribution de l’espèce humaine à l’écosystème. Tel serait précisément une économie devenue enfin profitable.
La coopération
L’homme n’est pas l’être abstrait des théories économiques classiques qui entretient un rapport solipsiste avec lui-même, ne s’agrégeant aux autres que par intérêt. C’est un être vivant inséré dans des groupes, qu’ils soient familiaux, ethniques ou religieux, dans des communautés de proximité créées par le travail ou l’habitat, ou bien encore dans des communautés plus idéales comme la société citoyenne ou l’universalité des hommes et des femmes.
La coopération suppose d’envisager les relations humaines autrement que sous la forme de la compétition et de l’affrontement. Promouvoir pleinement la coopération comme moteur social reviendrait à reconfigurer l’esprit même de la démocratie, à ne plus simplement la percevoir comme un espace de régulation des oppositions et des différences. Une société moderne devrait pouvoir reconnaître les spécificités propres de chacun de ses membres sans aliéner ni leur identité ni leur culture tout en leur permettant de participer individuellement et collectivement à un projet commun. En retour, chaque individu devrait se sentir lui-même comme un membre engagé, solidaire et responsable d’un nous social. Seules de puissantes valeurs partagées soutiennent à la fois l’autonomie des individus et l’ordre social. Une société qui promeut de telles valeurs est une société non d’agrégation mais de coopération, une société non d’opposition mais de conciliation, une société où les individus se sentent appelés à œuvrer par des actes et des engagements communs.
La coopération suppose d’envisager les relations humaines autrement que sous la forme de la compétition et de l’affrontement. Promouvoir pleinement la coopération comme moteur social reviendrait à reconfigurer l’esprit même de la démocratie, à ne plus simplement la percevoir comme un espace de régulation des oppositions et des différences. Une société moderne devrait pouvoir reconnaître les spécificités propres de chacun de ses membres sans aliéner ni leur identité ni leur culture tout en leur permettant de participer individuellement et collectivement à un projet commun. En retour, chaque individu devrait se sentir lui-même comme un membre engagé, solidaire et responsable d’un nous social. Seules de puissantes valeurs partagées soutiennent à la fois l’autonomie des
Par-delà le temps qui passe
Un monde partagé suppose une stabilité minimale des formes et des êtres, même si ceux-ci évoluent, naissent, vivent et meurent. Les propriétés qui les identifient, les relations qui les lient doivent avoir une certaine permanence au sein d’un espace commun, sans quoi tout n’est que confusion et désordre. Aujourd’hui pourtant, l’instabilité et la complexité rendent difficile notre présence au monde. Le philosophe et sociologue britannique Zygmunt Bauman recourt à la métaphore de la liquidité pour souligner une caractéristique essentielle des sociétés contemporaines :
« La modernité est en train de passer de la phase solide à une phase liquide, dans laquelle les formes sociales (les structures qui limitent les choix individuels, les institutions qui veillent au maintien des traditions, les modes de comportement acceptables) ne peuvent plus se maintenir durablement en l’état parce qu’elles se décomposent en moins de temps qu’il ne leur en faut pour être forgées et se solidifier. »
Les relations humaines, devenues à leur tour « liquides », témoignent de ce bouleversement social. Les possibilités d’établir de nouvelles relations, de s’impliquer dans de nouveaux espaces, d’opter pour de nouveaux choix, se multiplient à l’infini. Mais cette ouverture se double de sa possibilité inverse, celle de pouvoir se retirer aussi vite et sans préavis : le désengagement instantané est devenu la condition préalable de tout engagement. Les passions s’avivent et s’effacent au gré d’intérêts nouveaux. Internet, par son immédiateté et sa généralisation, contribue sûrement à l’accélération de ce processus.
Dans un monde où les relations se liquéfient, que peuvent donc encore signifier la confiance, la fidélité ou simplement dire « Je t’aime » ? Zygmunt Bauman a écrit de belles pages sur la difficulté d’aimer aujourd’hui, les envolées et les échecs des relations amoureuses. Les coûts psychologiques et émotionnels de cette liquidité sont le plus souvent niés, comme s’il s’agissait du prix à payer pour rester toujours libre. Pourtant, dans l’épaisseur des relations humaines, toute rupture, même la plus éphémère, pénètre notre subjectivité. Elle ne s’efface pas.
Quittant la terre ferme et ses assurances, il ne semble y avoir d’autre choix que de couler ou de surnager, puisque le monde lui-même se liquéfie sous la forme de multiples flux : flux d’informations, flux économiques, flux de marchandises, flux migratoires. De la même manière que le virtuel et le réel ne s’opposent plus, les distinctions formelles qui ont structuré les espaces s’effacent, qu’il s’agisse du dehors et du dedans, du privé et du public. Certes les limites demeurent, mais elles deviennent de plus en plus poreuses au quotidien. Des positions provisoires, des postures fluctuantes ; des flux qui s’accélèrent et se complexifient ; des divisions intangibles qui vacillent. Ces transformations défont l’assurance d’un monde. Le sentiment de partager une même communauté de destin se double désormais de celui d’éclatement et de morcellement. Nos actes, même les plus audacieux, paraissent se dissoudre dans un vaste maelström qui absorbe les initiatives. La peur, la résignation, l’angoisse et la démission redoublent. S’extraire de cette spirale négative supposerait de se réapproprier, individuellement et collectivement, le temps. Vivre ensemble ne suppose pas simplement en effet une vie en commun mais une inscription dans une temporalité, avec un futur à bâtir ensemble. Le don, la parole aimante, l’action profitable, la coopération réactivent ces facultés de responsabilité et d’engagement. Être responsable, s’engager, c’est pouvoir en effet répondre de ses actes par-delà le temps qui passe.