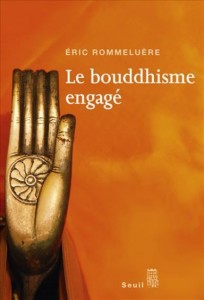« Inspirés par des valeurs bouddhiques, les bouddhistes engagés sont unis par la volonté commune d’aplanir la souffrance du monde par un « engagement » versus le renoncement) au sein des multiples institutions, structures et systèmes sociaux, politiques, économiques, etc., dans la société. Un tel engagement peut prendre différentes formes (comme le vote, le lobbying, la protestation pacifique, la désobéissance civile) mais il vise toujours à provoquer activement et à transformer ces institutions perçues comme perpétuant la souffrance sous diverses formes d’oppression ou d’injustice. »
Thomas Freeman Yarnall, « Engaged Buddhism : New and Improved!(?) Made in the USA of Asian Materials », Journal of Buddhist Ethics, 7, 2000.
Un bouddhisme transversal
Le bouddhisme est multiple, pluriel, divers, complexe. En Occident se côtoient désormais des moines zen, des lamas tibétain en exil, des moines cambodgiens et sri lankais de l’école theravāda ainsi que des vénérables vietnamiens pétris d’amidisme (un bouddhisme de la foi particulièrement vivace dans l’aire chinoise). Disparité des enseignements, juxtaposition des écoles. Pourtant, depuis quelques dizaines d’années, un nouveau courant de pensée bouddhique prend de l’ampleur qui les traverse toutes : le bouddhisme engagé. Ce mouvement pan-bouddhique, qui n’est pas issu d’une école particulière et que l’on retrouve aussi bien en Orient qu’en Occident, exprime une position novatrice : un bouddhiste peut (ou mieux doit) s’engager dans la vie politique, économique ou civile afin de concrétiser un idéal de société juste et équitable, quitte, et c’est là l’une des nouveautés, à s’opposer aux structures établies. Au cours de l’histoire, les moinesbouddhistes se sont le plus souvent constitués en communautés de retraitants et rares sont ceux qui ont remis en cause les systèmes politiques dans lesquelles ils évoluaient, même les plus despotiques. La conformité des communautés monastiques à l’ordre établi a toujours été plus ou moins de rigueur. Mais peut-on aujourd’hui se contenter d’enseigner une religion lorsque les hommes ne mangent pas à leur faim, n’ont pas de toit où s’abriter ou n’ont pas accès à l’éducation ? Le sentiment est ainsi apparu que les bouddhistes se devaient également de répondre à une souffrance plus globale que la simple souffrance psychologique ou existentielle. Qu’il leur fallait aussi affronter les inégalités sociales, les problèmes matériels, les difficultés économiques et même les oppressions.
Ce mouvement est encore peu connu en France, même si l’une de ses figures, le moine vietnamien Thich Nhat Hanh y vit et y enseigne depuis une quarantaine d’années. Il prédomine en Amérique, dans les pays anglo-saxons ainsi qu’en Allemagne, pays où le bouddhisme est enraciné depuis plusieurs dizaines d’années. Il a déjà de multiples visages, selon que ses membres s’engagent dans l’action sociale ou dans le militantisme politique. Un clivage s’est même formé entre ceux qui voient dans cette forme d’engagement un complément nécessaire aux activités traditionnelles enseignées au sein de leur propre école (méditation, étude, etc.) et ceux, plus radicaux, qui considèrent le bouddhisme engagé comme une « voie spirituelle » à part entière. Cette dernière tendance reste cependant minoritaire. Leurs champs d’activités sont des plus variés : l’aide aux détenus, la construction d’hôpitaux, le militantisme, la réflexion sur l’éducation ou l’économie, la participation à des mouvements pacifistes ou écologiques, etc.
Pour ces engagés, le bouddhisme se vit également comme un combat social et/ou politique. Certains retireront de leurs impôts un pourcentage correspondant à la part réservée au budget de la défense. D’autres ne seront plus simplement végétariens par conviction philosophique mais par réelle conscience politique, afin de montrer leur opposition à la société de consommation.
Un point de rencontre entre l’Orient et l’Occident
Le bouddhisme engagé est un bouddhisme moderne né de la rencontre et des interactions entre les idéaux de l’Orient et de l’Occident, l’un porteur d’une tradition de libération intérieure, l’autre d’une tradition de liberté politique. Robert Aitken (1917-2010), l’un des pionniers de ce nouveau bouddhisme, décrit ainsi cette rencontre, d’un point de vue occidental : « Nous autres bouddhistes occidentaux, bâtissons sur une tradition de responsabilité sociale qui existe depuis Moïse, Jésus et Platon mais aussi sur une autre tradition de droiture qui s’est formée dans des monastères de yogis, de taoïstes, de bouddhistes ainsi que dans les institutions confucianistes. Par cette synthèse, le bouddhisme en Occident est assuré d’appliquer l’éthique d’une nouvelle manière. » Dans cette nouvelle forme de bouddhisme, les notions civiles de liberté, d’égalité et de fraternité font désormais écho à des idéaux spirituels comme le partage ou le respect.
Si le terme a été forgé pendant la guerre du Viêt Nam par Thich Nhat Hanh, le bouddhisme engagé, comme réponse aux problèmes sociaux et politiques, a déjà une histoire centenaire en Asie ; à l’origine, il s’agissait d’une lecture bouddhiste du marxisme. L’idéal communiste a semblé à ses premiers lecteurs orientaux, une version étrangement proche du modèle communautaire prôné par le Bouddha. Et dès le début du siècle, émergeait ça et là l’idée d’un « bouddhisme socialiste » ou d’un « bouddhisme radical ». Ce premier élan fut le plus souvent réprimé violemment. Pendant la guerre russo-japonaise du début du siècle, une affaire qui impliquait des religieux eut ainsi un grand retentissement au Japon. Vingt-six personnes appartenant à un mouvement d’inspiration marxiste et anarchiste furent arrêtés pour haute trahison et conjuration contre l’Empereur. Parmi eux, l’éditeur de la traduction japonaise du Manifeste du Parti Communiste et quatre moines bouddhistes gagnés à la cause du Peuple. L’un de ces moines, Gudō Uchiyama, de l’école zen, a laissé une œuvre écrite abondante qui permet de cerner ses réflexions. Ses lectures des auteurs socialistes l’avait amené à la conclusion que les doctrines bouddhistes et marxistes partageaient le même idéal social. Il lui parut alors de son devoir de moine de militer pour le désarmement, le pacifisme et la nationalisation des terres. Lorsqu’en 1907, le parti socialiste japonais fut interdit, Uchiyama continua à imprimer dans la clandestinité ses livres où il appelait à des réformes sociales et économiques. Arrêté en 1909, il fut condamné à sept ans de réclusion pour activités subversives. Alors qu’il était en prison, d’autres militants furent arrêtés. On relut ses livrets et ses tracts, comme son Manuel pour les soldats impériaux, où il appelait les militaires à déserter. Finalement accusé de haute trahison, Uchiyama, moine bouddhiste et marxiste, fut passé par les armes avec plusieurs autres conjurés. Cette affaire qui marqua l’opinion japonaise de l’époque est, à cet égard, révélatrice de cette rencontre inattendue entre l’Orient et l’Occident.
De telles prises de position étaient marginales. Mais elles marquaient une nouvelle prise de conscience : le bouddhisme pouvait désormais avoir un rôle politique et social contre ou indépendamment des autorités ou des structures établies. La connivence du bouddhisme et du marxisme a été par la suite bien réelle en Asie. Lors de la lutte pour l’indépendance de Ceylan, nombre de moines prirent ainsi fait et cause pour des mouvements d’inspiration socialiste ou communiste. Aujourd’hui, la tentation marxiste n’est plus, comme on peut l’imaginer, de mise. Gandhi, figure de la non-violence, a désormais remplacé Marx dans les icônes du bouddhisme engagé. Néanmoins, ce mouvement reste largement pétri d’idéaux socialistes tout au moins dans ses versions politisées.
Panorama des réseaux de bouddhistes engagés
À l’heure actuelle, la plupart des bouddhistes engagés sont regroupés au sein de deux grandes organisations internationales : The Buddhist Peace Fellowship (BPF) et The International Network of Engaged Buddhists (INEB). La première a son siège aux États-Unis, la seconde en Asie. Indépendamment de ces deux réseaux, de nombreuses autres organisations bouddhistes travaillent également dans le champ de l’engagement politique et social. Ce sont le plus souvent des émanations d’une tradition particulière, comme le récent Zen Peacemaker Order créé par Bernard Glassman, qui entend marier le zen et l’engagement social. Le BPF et l’INEB sont, elles, des organisations pan-bouddhistes. Leurs objectifs dépassent l’aide directe aux démunis et la simple coordination de programmes sociaux. Elles fonctionnent comme des réseaux de réflexion et proposent des projets de société alternative.
Le Buddhist Peace Fellowship est avant tout l’œuvre d’un homme, Robert Aitken, l’un des pionniers du bouddhisme zen américain. Né en 1917, Aitken s’intéressa au bouddhisme alors qu’il était interné au Japon pendant la seconde guerre mondiale. Il continua après la guerre son apprentissage auprès de maîtres japonais et fut finalement reconnu comme un enseignant au sein de l’école zen Sanbō kyōdan, « La Société des Trois Trésors ». Parallèlement, il s’impliqua dans l’activisme qu’il vivait comme un complément nécessaire à sa pratique bouddhiste. Il milita contre les essais nucléaires américains dans les années 50, puis contre la guerre du Viêt Nam dans les années 60. Aitken fut l’un des premiers bouddhistes américains à pratiquer la désobéissance civile en refusant de payer la part de ses impôts affectée au budget de la défense. Ce qui est, soit dit en passant, totalement impensable dans le contexte du zen japonais où la soumission à l’État et plus généralement au groupe social est impérative. Attaché à ses maîtres, Aitken, a toujours néanmoins clairement séparé le message du zen de ce qu’il se considérait comme des travers de la culture japonaise.
Les réflexions des bouddhistes américains sur leur engagement politique datent de cette époque où la guerre du Viêt Nam obligeait tout un chacun à prendre position. En 1969, Gary Snyder (le Jaffy Ryder des romans de Jack Kerouac), l’un de ces intellectuels gagnés au bouddhisme, republiait un fameux article où il critiquait les institutions bouddhistes qui acceptaient ou ignoraient les inégalités dans lesquelles elle vivaient et par là même cautionnaient les tyrannies. Il y disait : « La révolution sociale a été la miséricorde de l’Occident. L’éveil personnel dans le soi fondamental, la vacuité, la miséricorde de l’Orient. Nous avons besoin des deux. » (« Buddhism and the Coming Revolution », Earth House Hold). Quelques années plus tard, Robert Aitken fondait le Buddhist Peace Fellowship avec les membres de sa communauté zen et quelques personnalités du monde bouddhiste comme Gary Snyder. Son audience fut d’abord limitée à Hawaii où habitait Aitken puis à la Californie mais son influence s’étendit rapidement dans tous les pays anglophones. Aujourd’hui, le BPF compte environ 4.000 membres. C’est l’une des organisations américaines les plus actives en matière de désarmement, d’écologie ou des droits de l’Homme. En 1987, elle fut la co-instigatrice d’une réunion interreligieuse au Honduras et au Nicaragua afin de résoudre la crise politique dans ces pays. Elle développe aujourd’hui divers programmes d’aide sociale en Asie.
Plus récente et moins importante que le Buddhist Peace Fellowship, The International Network of Engaged Buddhists (INEB) n’en reste pas moins l’organisation la plus novatrice en matière de réflexions théoriques. Son siège est à Bangkok mais, comme son nom l’indique, elle est constituée en réseau et compte 400 membres appartenant à 33 pays différents. Le Dalaï-Lama, Thich Nhat Hanh et Mahâ Ghosananda qui appartiennent à trois traditions différentes (bouddhisme tibétain, zen vietnamien, theravâda cambodgien) en sont membres d’honneur. L’INEB est née en 1989 à l’initiative de Teruo Maruyama et Sulak Sivaraksa. Le premier est un Japonais, prêtre de l’école japonaise Nichiren-shū. Ancien membre du Parti Communiste, Maruyama est connu dans son pays pour ses critiques acerbes des institutions religieuses et pour ses diverses campagnes non-violentes (contre les consortiums de l’industrie chimique et la construction de l’aéroport de Tōkyō notamment). Le second, le docteur Sulak Sivaraksa, est Thaïlandais et demeure l’un des principaux théoriciens du mouvement. Lui-même se dit influencé par la pensée de Thich Nhat Hanh, de Gandhi et des Quakers. Même s’il s’en démarque, il reste également profondément imprégné du modèle marxiste. Dans son propre pays, Sulak Sivaraksa fut longtemps inquiété pour ses activités considérées comme subversives.
Les actions de l’INEB sont multiples et ponctuelles. La section japonaise du réseau milite par exemple pour la reconnaissance des exactions du Japon pendant les dernières guerres : massacre de Nankin, expérimentations des médecins japonais pendant la seconde guerre mondiale, etc. L’INEB-Japon s’en prend également à un autre tabou de la société japonaise : l’esclavage sexuel contrôlé par les yakuza, les mafieux locaux, n’hésitant pas à opérer dans des conditions rocambolesques pour sauver des prostituées. Achetées entre 25 et 50.000 euros dans leur pays, on estime ainsi que 50 à 70.000 thaïlandaises seraient forcées de se prostituer au pays du Soleil Levant. Les membres de l’INEB – parfois des moines – se rendent dans les bars à prostitution où ils essayent de sensibiliser les jeunes femmes en se faisant passer comme clients. Lorsque le contact est établi et que l’une d’entre elles manifeste le désir de s’échapper, ils organisent son enlèvement. Opération difficile et dangereuse, les bars se trouvant sous la surveillance étroite des gangs. Ils débarquent en grand nombre et dans la confusion, l’enlève. Quelques dizaines de Thaïlandaises ont ainsi pu être délivrées au cours des dernières années.
Autre action récente menée, cette fois-ci en Thaïlande, par le docteur Sulak Sivaraksa : l’INEB s’est opposée en 1998 à la construction d’un gazoduc long de 260 kilomètres acheminant du gaz birman jusqu’à la province thaïlandaise de Ratchaburi. L’INEB, comme de nombreuses groupes d’opposition thaïlandais, accusaient la PTT (Petrol Authority of Thailand), le consortium pétrolier national, de n’avoir pas suffisamment dédommagé les populations locales, d’avoir négligé la protection de l’environnement et, plus grave encore, de financer et de soutenir indirectement la junte militaire birmane par l’achat de ce gaz. Malgré leurs multiples batailles (Sulak Sivaraksa s’est enchaîné au gazoduc en construction puis a mené des actions judiciaires contre le gouvernement), l’ensemble est aujourd’hui en fonction.
Une utopie ?
Par de telles opérations, les bouddhistes engagés veulent montrer qu’une approche traditionnelle est dépassée et que le bouddhisme se doit de trouver des réponses appropriées aux problèmes contemporains. Quoi que nous fassions, nous sommes impliqués dans la mondialisation et dans la globalisation des économies. Comment respecter le précepte de ne pas tuer lorsque nos impôts contribuent également au budget de la défense ? Comment respecter le précepte ne pas voler lorsqu’en achetant des produits de consommation nous contribuons à l’exploitation du tiers-monde ? Pour un Sulak Sivaraksa, la simple participation à la société de consommation viole tous les principes éthiques (voir ci-dessous). La souffrance, problème essentiel du bouddhisme, acquiert une nouvelle dimension dans nos sociétés. Une pensée bouddhiste doit donc désormais inclure une réflexion sur notre implication dans le monde, nos relations avec l’État, les entreprises ou les multinationales. Pour les bouddhistes engagés, l’action est également nécessaire afin de modifier les rapports de forces entre les individus et les acteurs sociaux. Le respect, la non-violence, la compassion sont les leitmotivs de ces nouveaux artisans de la paix. Changeront-ils le monde ? En tout cas ils ont promis d’œuvrer, selon le vœu bouddhiste, « tant qu’il y aura des êtres à sauver ».
Éric Rommeluère (1999, 2014).
« En rendant le bouddhisme plus proche du monde contemporain, il ne s’agit en aucun cas d’oublier l’essentiel, notamment les principes éthiques. Il faut simplement leur redonner un sens dans les sociétés où nous vivons. Dans les sociétés agraires où le bouddhisme s’est développé, les choses étaient plus simples… On pouvait dire « je ne tue pas, je ne vole pas, je ne commets pas l’adultère, je ne mens pas. Je suis quelqu’un de bien » mais avec la complexification grandissante de nos sociétés, ça ne marche plus comme ça! (…) S’abstenir de tuer tout être vivant n’est plus aussi simple. Nous devons nous interroger : Pouvons nous admettre que nos impôts servent à l’armement ? Devons nous élever des animaux pour les tuer ? Concernant le deuxième précepte, ne pas voler, il faut aussi s’interroger : même si nous ne dérobons rien directement, pouvons-nous accepter de voir les pays riches exploiter les pays pauvres via le système bancaire international et l’ordre économique mondial ? En fait, participer à tout le système de consommation c’est déjà risquer à chaque instant de violer les trois premiers préceptes! Quant au quatrième, s’abstenir de paroles mensongères ou incorrectes, c’est particulièrement difficile dans un monde fondé sur la communication publicitaire et la propagande politique… En fait la souffrance, qui, certes, pouvait être souvent effrayante au temps du Bouddha, était pourtant plus simple à comprendre. L’interdépendance entre les phénomènes est devenue une chose très complexe… Si nous n’adaptons pas la sagesse bouddhiste à la compréhension de la réalité sociale et à la recherche d’une réponse aux questions qu’elle pose, alors le bouddhisme risque de n’être qu’une sorte d’échappatoire aux problèmes de ce monde, à l’usage des classes moyennes. »
Extraits d’une interview de Sulak Sivaraksa parue dans le magazine américain Turning Wheel (1994, traduction française Jean-Paul Ribes).